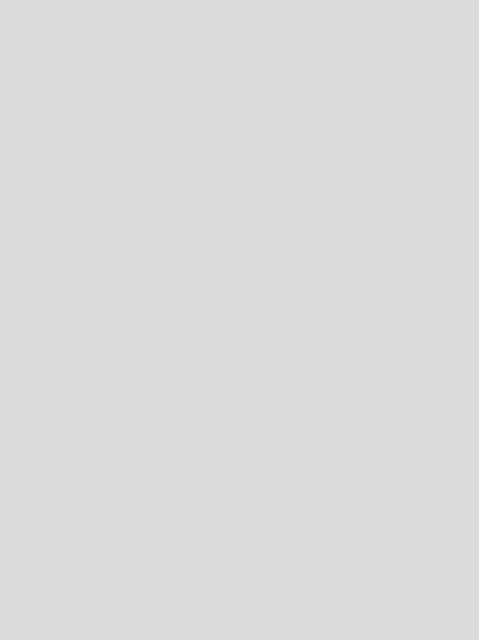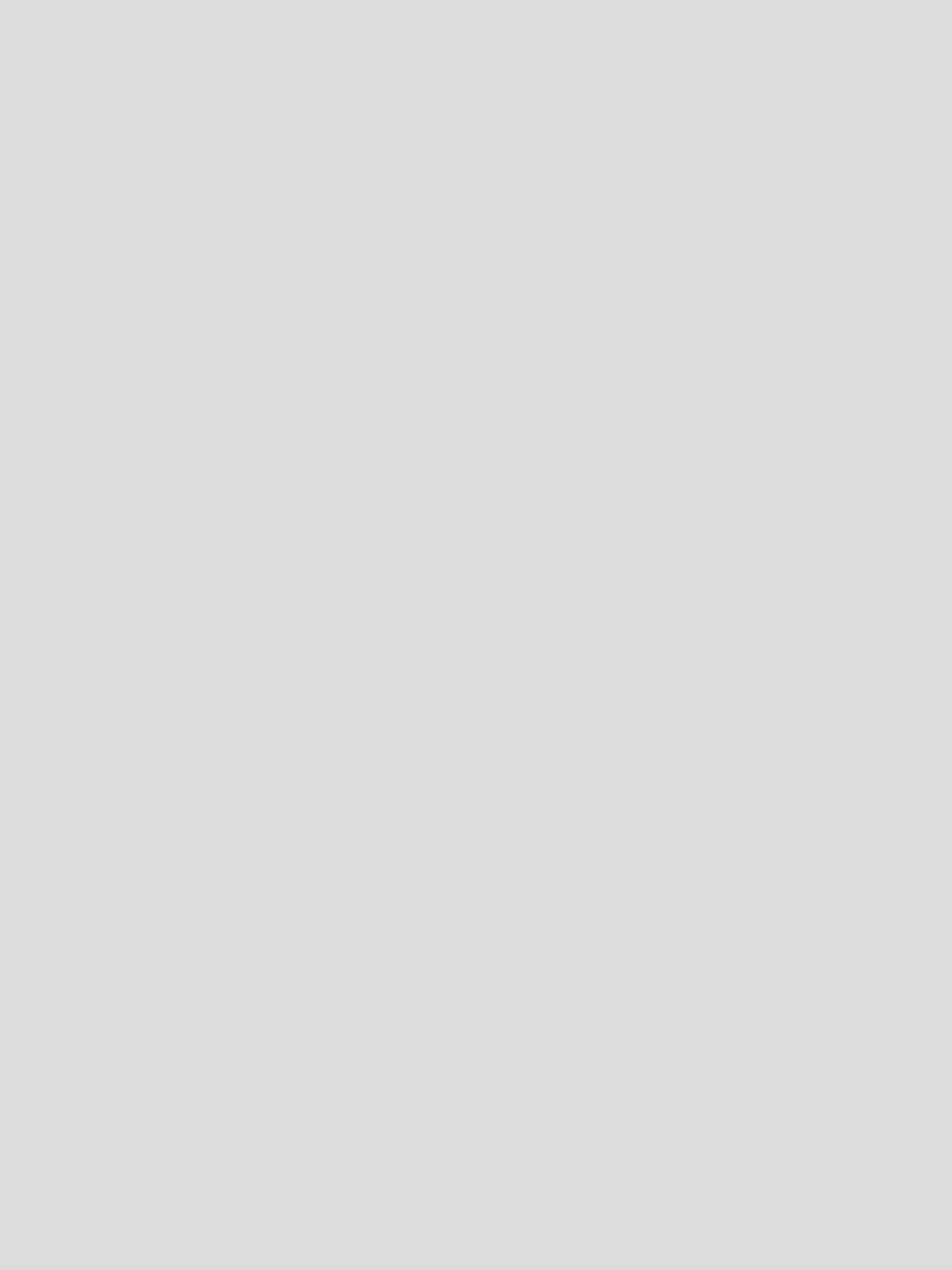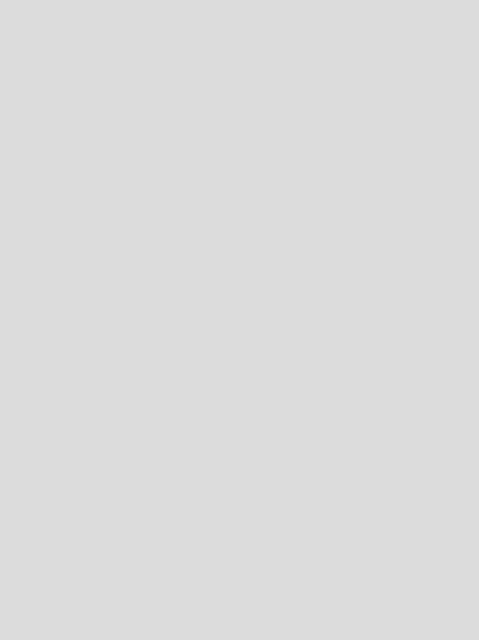Jacqueline Osty est née au Maroc et a passé son enfance à Casablanca avant de venir à Paris étudier l’architecture à l’École des beaux‑arts, puis le paysage à l’École du paysage de Versailles, dont elle est sortie diplômée en 1982. Cette double formation l’a guidée prioritairement vers le paysage urbain et amenée à s’interroger sur ce que signifie « faire la ville » avec les moyens du paysage.
Prix de l’aménagement urbain en 1994 et Prix du paysage en 2005, le parc Saint‑Pierre à Amiens a été l’occasion pour la paysagiste de penser la relation entre ville et territoire, entre les formes d’une géographie et celles d’un tissu urbain. Le site du parc, près des hortillonnages de la Somme, l’a engagée à dessiner un parc selon une double inspiration, une double logique qui permet une osmose entre les deux pôles en présence, la ville et la campagne, en profitant d’une agriculture maraîchère qui semble être un parcellaire allant sur l’eau. Le projet réalise une couture du parc et des hortillonnages autant que du parc avec les différentes facettes de la ville.
Coudre et tisser la ville, cela résume une longue série de créations qui ont suivi et développé chez Jacqueline Osty une capacité d’aborder le projet urbain, soit dans une étroite collaboration avec des architectes, soit comme seule mandataire. On peut citer le quartier de Beauregard à Rennes, avec Loïc Josse, une invention de « ville bocage », ou le quartier Baud‑Chardonnet également à Rennes, avec Bernard Reichen, un morceau de « ville au bord de l’eau ». L’atelier Jacqueline Osty et Associés, avec l’urbaniste Claire Schorter, travaille actuellement sur une nouvelle phase de l’aménagement de l’Île de Nantes, une des situations les plus complexes qui soient.
Outre de nombreuses autres réalisations en France et à l’étranger, deux projets parisiens ont particulièrement compté dans le parcours de Jacqueline Osty : le parc Clichy‑Batignolles et le parc zoologique du bois de Vincennes. Il s’agissait, dans les deux cas, de faire place à la nature dans la ville, à Paris, mais de deux manières très différentes. Pour Clichy‑Batignolles, la création d’un paysage en partant des impératifs du développement durable, soit un paysage né de savoirs techniques au service d’un spectacle de la nature en ville. Pour le zoo, la création de paysages qui sont comme des citations de natures lointaines pour accueillir la présence la plus intense du vivant, les animaux sauvages. Cette priorité accordée à la nature n’a pas empêché, à Clichy‑Batignolles, de continuer, avec l’architecte François Grether, le travail de couture d’un parc à son quartier, avec un tracé dans la continuité des rues existantes.
L’aménagement de l’écoquartier Flaubert à Rouen, actuellement en cours, et dont la promenade des quais a reçu le Prix du paysage 2018, est un projet global dans une ville où Jacqueline Osty a déjà réalisé le parc Grammont, pour un quartier enclavé de la rive gauche, afin de l’ouvrir au grand paysage et de l’inscrire dans la ville dont les habitants se sentaient séparés. L’écoquartier Flaubert, c’est, à la fois, l’invention d’un nouveau tissu urbain connecté à l’existant qui l’entoure, la réalisation d’espaces publics nouveaux sur les quais du fleuve et dans le quartier luimême, et au total la création d’un grand paysage profitant de la géographie exceptionnelle de la vallée de la Seine, tout en permettant une gestion écologique des espaces publics. Plus qu’un parc et son quartier : une ville‑nature au bord de l’eau.
Cette demande de nature en ville ne cesse d’augmenter. Depuis 2018, les projets actuels de l’atelier Jacqueline Osty et associés en témoignent tous. En particulier celui de la place Feydeau-Commerce à Nantes ou celui de la place Pradel-Tolozan, en plein centre-ville resté très minéral. Également celui des Promenades de Reims, longtemps dominées par une voierie réservée aux voitures et maintenant ouvertes à d’autres usages dans un paysage de sous-bois. Ou encore le récent concours gagné à Angers pour réaménager deux places aux pieds d’une église et du château du Roi René, jusqu’ici offertes en priorité à la circulation au lieu d’être les esplanades des monuments. Le parcours singulier de Jacqueline Osty se poursuit…
Lire la biographie
La ville et la vie
Autobiographie scientifique
Qu’est‑ce qu’un paysagiste, qu’est‑ce qu’un urbaniste ? Je me suis parfois posé la question, parfois seulement, car le plus souvent l’interrogation sur la compétence requise devant le fait urbain passait derrière l’action. La nécessité de s’engager rapidement dans un projet selon les règles et les rythmes d’un concours ou d’une consultation a trop souvent empêché les moments où j’aurais voulu prendre de la distance avec l’exercice de mon métier. Peu à peu, cependant, les contours d’une singularité ont quand même fini par se dessiner à mes yeux, non seulement la mienne, au niveau de ce qu’on peut appeler pour chaque maître d’oeuvre un style, mais également au niveau du métier lui‑même et de la façon de le pratiquer des femmes et des hommes d’une génération de l’école du paysage de Versailles.
Je suis née à Casablanca, en 1954, deux ans avant que le Maroc accède à l’indépendance. Ma mère était née à Oran, d’origine espagnole, et mon père était né en France, venu seulement à 19 ans au Maroc pour rendre visite à sa soeur, installée dans le pays avec un mari ingénieur d’une mine d’étain dans la montagne. Mon père est resté, séduit par le pays et ses paysages après en avoir fait le tour en vélo. La vie au Maroc en ce temps‑là se déroulait encore dans le cadre colonial établi par les Français. Je vivais dans une ville singulière, ni française ni arabe, la ville dessinée par Henri Prost et construite par des architectes inspirés à la fois par la modernité métropolitaine et par l’héritage mauresque — une ville double, dotée d’une médina labyrinthique entourée d’un tissu spacieux de places et de grandes avenues. Pour moi, une ville installée dans le vivant, depuis ma rue des Martins‑Pêcheurs, dans le quartier Oasis, plantée de jeunes palmiers, jusqu’à la plage de Manesman où mon père avait acquis un « cabanon ».
La villa familiale possédait de grandes baies vitrées ouvertes sur une terrasse et un jardin foisonnant très coloré : rouge des hibiscus, bleu mauve des jacarandas, jaune des mimosas et des citronniers, rose des lauriers et des bougainvilliers… Le parc Lyautey, non loin de la maison, m’offrait une échelle intermédiaire de paysage « naturel » entre celui que je contemplais depuis la terrasse et celui de l’océan qui s’offrait au regard depuis le cabanon. Entre l’intime et le grand large, mais sans que celui‑ci soit dépourvu d’un foisonnement aussi enchanteur que celui du
jardin. La plage était parsemée de grandes surfaces rocheuses à étrange texture nid d’abeille qui accueillaient une vie intense, chaque trou d’eau y abritait un monde en soi, une petite communauté aquatique d’algues
colorées, de nacres et d’anémones pourpres, de poissons argentés et de crabes velus. Les cabanons étaient posés sur la dune, derrière laquelle un tapis d’arbustes offrait un autre territoire d’exploration : tamaris, ricin, doum, canne de Provence… Avec le recul, je mesure combien j’ai pu là‑bas, d’une rue à une plage, me sensibiliser au détail autant qu’à l’immense, au proche et au lointain, sans jamais les séparer, tant ils s’offraient à moi dans l’unité du vivant et dans la mouvance incessante des saisons et des marées, de la lumière et des couleurs. Une appréhension du paysage — de ma « ville‑paysage » — avant tout sensible parce que saisi de manière sensuelle avant de se laisser décrypter avec des concepts géographiques et des nomenclatures botaniques. Le Maroc de mon enfance était réellement un monde sensuel, où tout ramenait au plaisir, qu’on y traîne au marché pour les grandes tablées familiales, au milieu des amoncellements bigarrés de fruits et légumes, de viandes et d’épices, ou qu’on aille marcher dans l’arrière‑pays le long des oueds pour y cueillir des narcisses et des asphodèles au début du printemps. La marche ! Le goût de la marche qui m’initiait à la topographie d’un pays et peu à peu à la forme de ses villes composites, Rabat, Fez, Meknès, et d’abord Casablanca.
À l’adolescence, j’ai parcouru la ville en bus, en vespa, en voiture, assimilant progressivement sa taille et ses limites, mais c’est surtout en marchant que l’arpentage a été instructif. Une marche « en dansant », je peux presque le dire, tant les cours de danse ont rythmé alors mon quotidien, jusqu’au point où j’ai plus tard hésité pour mes études entre l’architecture et la chorégraphie. La danse était une exploration de l’espace du plateau par le geste, à l’âge où j’explorais l’espace urbain par la marche. C’était privilégier le corps comme instrument de maîtrise de l’espace — ce qui m’est resté dans la priorité que j’accorde à la « promenade » pour découvrir un site de projet, une promenade « insistante », mêlant l’analyse et la sensation, crayon en main, parfois le pinceau —, mais pas seulement, car l’apprentissage de la danse était aussi celui d’un lieu de mise en scène et de coulisses, choses fascinantes qui ont orienté l’apprentissage concomitant de la ville, me faisant y déceler aussi des scènes et des coulisses et m’amenant plus tard, au cours de ma vie professionnelle, à créer des successions d’ambiances, à envisager des scénographies urbaines qui puissent rivaliser avec des scénographies théâtrales. Les villes marocaines m’apparaissent aujourd’hui comme des preuves de la légitimité de cette façon de penser la fabrique de la ville, que je ne faisais que pressentir alors, dans une conscience inachevée. Prost et Forestier, dont j’ai découvert le rôle au Maroc pendant mes études aux Beaux‑Arts, avaient bien été des scénographes urbains tout en étant soucieux de résoudre les problèmes techniques de l’aménagement. Grâce à eux, j’ai vécu d’abord dans une harmonie urbaine exceptionnelle qui m’a semblé être le fruit d’une collaboration sans heurts des « faiseurs de ville », architectes, urbanistes, jardiniers, sous la houlette d’un gouverneur, Lyautey, qui avait désiré passionnément fabriquer Casablanca. C’était ce que je comprenais depuis Paris au moment où je commençais mes études d’architecture.
Ces études ont été à la fois enrichissantes et insatisfaisantes, car la cohérence de ma ville natale, la manière dont on n’y avait pas séparé l’herbe et le béton, le sable des plages et l’asphalte des rues, dans le tracé de son plan et le choix de ses formes, n’avait pas d’écho dans l’enseignement délivré alors. C’est la raison pour laquelle je suis allée poursuivre ma formation à Versailles pour devenir paysagiste. Je parlais plus haut de « génération », il s’agit de celle qui était dans l’école à ses débuts, à la fin des années soixante‑dix et au début des années quatre‑vingt. On y trouve entre autres, avec peu de décalage de dates des diplômes, Alexandre Chemetoff, Michel Desvigne, les trois fondateurs de l’agence TER… et moi‑même, issue de Versailles en 1982. Comme chacun a pu aisément le constater, les agences créées par les uns et les autres ont montré des styles différents, perceptibles en termes d’espace ou de botanique, d’ambiances attachées à des goûts que l’on peut dire artistiques. Mais elles partagent quelques arcanes de l’approche paysagère de la ville.
Nous avons été formés par des gens qui s’étaient eux‑mêmes formés en accompagnant des chantiers urbains des années soixante‑dix, quand on ne parlait pas encore de « projets urbains » mais que l’on produisait
une nécessaire et intense réflexion sur la ville contemporaine en essayant de sortir des oppositions tranchées entre différentes théories de la forme urbaine, entre les partisans d’une radicalité revisitée des Modernes et ceux d’un retour vers les formes héritées de l’histoire. Jacques Simon et Michel Corajoud témoignaient d’une nécessité de penser et d’oeuvrer dans le cadre de la fabrique de la ville. Ils l’avaient fait à Reims, à Grenoble, et nous étions convaincus, en profitant de leurs enseignements, que là était notre destin : travailler dans la ville, la modifier, la façonner, la faire. Ce qui s’est vite révélé d’une grande complexité, une fois sortis de l’école, en affrontant nos premières situations de projets.
Dans les années quatre‑vingt, la complexité ne venait pas seulement de l’héritage des rôles attribués en France aux différents corps de métier attachés à l’urbanisme, de la position de prééminence occupée ici ou là par l’architecte ou l’ingénieur, l’aménageur ou le promoteur, presque jamais par le paysagiste. Elle venait également des débats d’idées qui traversaient le champ même de la ville et de ses formes. Les publications, depuis la décennie précédente, perturbaient la pensée convenue, défaisaient les certitudes, déstabilisaient les modèles. Il était difficile de se constituer la vision claire d’une conduite professionnelle après avoir lu des livres qui faisaient l’objet, à l’époque, d’une conversation ininterrompue entre les acteurs de la forme urbaine. Comment s’inspirer de ce qui s’écrivait alors et qui était véritablement passionnant, et que l’on trouvait souvent sur les tables à dessin et les étagères d’agences ?
Oui, comment trouver sa voie après lecture du Learning From Las Vegas de Venturi et Scott‑Brown, du Delirious New York de Koolhaas et des Manhattan Transcripts de Tschumi ? C’est pour la chercher que je suis partie aux États-Unis en 1981‑1982, afin de compléter ma formation dans l’agence Sasaki, Walker & Associates à Los Angeles. Ce que j’avais commencé à percevoir en lisant les livres cités — une part d’approche paysagère de la ville chez les architectes —, s’est confirmé et matérialisé dans la découverte de la réalité professionnelle de mon métier de l’autre côté de l’Atlantique : le paysagiste était le premier interlocuteur de l’aménageur ; la priorité était donnée à la structure paysagère et à l’organisation de l’espace public.
Si cette réalité n’était ni transposable ni souhaitable ici — une simple inversion des rôles ne serait pas aussi pertinente qu’une collaboration complice —, il était devenu évident à mes yeux que l’espace public était une préoccupation centrale pour un paysagiste, et singulièrement pour moi qui voyais soudain qu’il pouvait être l’objet d’une sorte de vocation personnelle que je devais assurément affirmer. J’ai créé mon agence en 1983 et, hasard objectif, j’ai commencé par la conception d’une place devant la mairie de Saint‑Mandé, et j’ai continué en enchaînant des réalisations diverses, des rues, des quais, des parkings… des éléments de vocabulaire de l’espace public, jusqu’à la conception du parc Saint‑Pierre à Amiens pour un concours gagné en 1990.
Ce parc a été abondamment commenté, il n’est pas nécessaire d’en redire tous les éléments, mais on peut le resituer dans son temps et son contexte, et exprimer avec le recul de trois décennies l’esprit dans lequel j’ai travaillé alors. Il y avait eu auparavant le concours du parc de la Villette, gagné par Bernard Tschumi en 1983, inauguré quatre ans plus tard. C’était un résultat de la tempête théorique de l’époque de sa conception, mais c’était aussi l’effet de la reconnaissance d’un parc comme espace pleinement public, au même titre qu’une grande place en centre-ville ou une large esplanade devant une gare. Au lancement du concours par François Barré, responsable de son programme, le projet avait été annoncé comme le premier parc du XXIe siècle. La Villette inaugurait une inscription définitive des parcs urbains dans la liste des espaces publics indispensables et incitait à l’appel d’un nouveau métier pour faire la ville, celui de paysagiste, même si Tschumi n’en était pas un.
À Amiens, le maire, Gilles de Robien, et moi étions confortés ensemble par cette bascule des idées, manifestée à l’occasion de La Villette, pour envisager le parc Saint‑Pierre comme une nouvelle centralité de la ville, ainsi qu’une place Stanislas à Nancy ou une place Bellecour à Lyon. Et j’étais, de mon côté, confortée dans la pertinence de mon regard de paysagiste pour y parvenir. Le chemin découvert a été celui de l’ajustement du parc à son entour au moyen d’une analyse faite à plusieurs échelles du territoire. Je m’aperçois aujourd’hui à quel point la conception du parc Saint‑Pierre m’a engagée sur une voie urbanistique sans rien perdre de la spécificité d’une formation qui aura été autant celle du regard que du métier — mais on ne peut guère les dissocier. J’ai compris, à cette occasion, que concevoir un morceau de ville, c’était d’abord regarder ce qui est déjà là, afin de l’accepter en ajustant son projet à l’existant par de multiples couches d’inscriptions territoriales : inscription géographique en s’accordant aux données morphologiques des eaux et des reliefs ; inscription agricole quand le travail paysan a laissé des traces singulières qui donnent parfois une forte identité aux lieux ; inscription urbaine par couture avec le tracé des rues et le réseau des espaces ouverts, de façon à reprendre à chaque fois l’infini tissage de la ville ; inscription mémorielle avec des mises en valeur du passé, monuments ou vestiges de ce qui fut vécu là et parfois célébré ; inscription proprement paysagère en ménageant des vues cadrées sur le proche et le lointain, la fuite d’une rivière
ou le profil d’une colline.
Je peux dire que les trente années suivantes ont été avant tout un approfondissement de ce que j’avais réalisé ou seulement esquissé à Amiens. Mais pas seulement ! J’ai effectivement décliné l’articulation de la ville et du paysage de multiples façons, ajustant les projets à des foyers d’intensité des usages — des places‑jardins associées à des équipements, théâtre ou cinéma, comme à Chartres avec Bernard Reichen — ou des traces d’anciens usages — comme à Rennes avec Loïc Josse en m’appuyant sur les anciens chemins d’une terre agricole pour amorcer
une « ville‑bocage ». J’ai également renforcé l’idée d’une dimension scénographique bénéfique pour les projets urbains, utilisant les reliefs géographiques ou les formes bâties comme structures des scènes ouvertes de la vie urbaine, skylines naturelles ou artificielles. Je ne peux penser être une paysagiste sans avoir toujours à l’esprit le souci d’un horizon, à révéler ou protéger. Mon travail à Rouen en est peut‑être l’exemple le plus probant : au parc Grammont où des vues sont ménagées sur des éléments fondamentaux de l’identité de la ville, la cathédrale et la côte Sainte‑Catherine ; au futur quartier Flaubert où les espaces publics seront raccordés au fleuve et ouverts sur un site portuaire mêlant les formes de l’industrie à celles de la géologie.
Ce qui est venu progressivement — bien que j’y ai été sensibilisée dès l’école par Gilles Clément, Marc Rumelhart, Pierre Dauvergne et Jacques Montégut, un ingénieur horticole, un botaniste, un paysagiste et un agronome —, c’est la conscience écologique appliquée à l’urbanisme et la façon d’en tenir compte dans mes projets. Cette conscience est en passe de devenir une souffrance écologique, après l’expérience planétaire d’une pandémie qui a stoppé, confiné l’humanité pendant deux mois. Dans le grand silence du confinement, l’appel de la vie s’est fait sentir à travers les villes bien au‑delà d’une idée qui gagnait les esprits depuis quelques années, pour devenir l’expression d’une fonction vitale, une véritable soif du vivant sous de multiples formes au sein même des territoires les plus asséchés par la pierre et le béton. Pour beaucoup, le rêve de la ville « durable » ou « fertile » s’est brutalement changé en exigence immédiate. Certains, qui ont eu la grande chance de passer la période de confinement dans des appartements avec vue sur un parc dans la ville, ont même imaginé — utopie ou non ? — la transformation de certains jardins publics en réserves naturelles intégrales, tant l’afflux des oiseaux en variétés et en nombre les avait non seulement émerveillés mais surtout rendus plus désireux d’un renversement de la relation de l’espèce humaine avec les plantes et les animaux, ses colocataires planétaires.
Pour les plus nombreux qui ont subi la promiscuité forcée de logements trop petits, l’impossibilité de se déplacer au‑delà d’un kilomètre de son domicile a rendu plus visible encore l’inégalité des quartiers d’habitations et montré les insuffisances de qualité des espaces publics. Même si l’on ne rattrape pas le manque de mètres carrés d’un logement avec un banc sur un trottoir, on est maintenant conscient comme jamais du besoin de trouver au plus près de chez soi toute la diversité de ce qu’on attend d’une vie de quartier, toute une aménité variée de l’espace partagé — plus d’hospitalité de la ville à l’échelle des corps, horizon d’un micro‑urbanisme nécessaire après les méfaits trop fréquents de l’aménagement à grande échelle.
Il y a maintenant une obligation sociale et politique, celle de penser autrement l’habitus de l’homme. C’est‑à‑dire produire, comme l’a théorisé Bruno Latour, une pensée en termes de territoires, à toutes les échelles, du village au monde en son entier, et bien sûr aux différentes échelles de la ville. Des territoires « transfrontaliers » qui débordent les anciennes limites, nationales ou administratives, pour retrouver des ensembles induits par des données où s’articulent géographie, économie et culture selon des logiques différentes de celles que nous connaissons avec la mondialisation. Nous sommes au début d’un grand chambardement qui peut devenir le grand chantier exaltant d’une réconciliation des vivants — tous les vivants — et des sols où ils transitent ou s’arrêtent, édifient un nid, un terrier, une maison, une ville.
À quoi sert un paysagiste dans ce contexte ? Comment puis‑je m’adapter à ce nouvel horizon de l’établissement humain ? En ville et ailleurs, car les unités territoriales envisageables pour aborder l’avenir seront nécessairement des unités de passage autant que de résidence, des lieux plus ou moins étendus mais toujours connectés à ce qui les déborde. Je pense, en regardant en arrière, que mon parcours m’y a préparée sans que j’aie pu, comme la plupart, mesurer l’ampleur des nécessités qui se révèlent aujourd’hui. Des nécessités qui se traduisent en termes de réparation et d’innovation urbaines, l’une et l’autre dans une perspective biologiquement positive. L’installation de couloirs et de stations pour favoriser la biodiversité pourrait être envisagée du seul point de vue scientifique et n’entraîner que des solutions purement techniques sans se soucier des transformations formelles induites. Ce qu’un paysagiste envisage, à cet égard, est d’emblée une volonté d’art, une volonté d’art urbain avec les mêmes objectifs écologiques — c’est même pour moi d’une poétique de la nature dont il s’agit, quand je peux mettre en scène en pleine ville le spectacle des saisons ou celui d’un inépuisable foisonnement. À Rouen, pour réparer le terrain pollué de l’ancien dépôt de charbon sur la presqu’île Rollet, j’ai remodelé le sol et planté des dizaines de milliers d’arbres dont la vertu est à la fois de redonner au site un nouvel « état de nature » et d’augmenter le territoire de la ville avec une sorte de forêt urbaine, ainsi qu’on nomme aujourd’hui ce genre d’aménagement. La presqu’île a été pour moi l’occasion d’inscrire l’ordre biologique dans l’ordre paysager sans qu’il y ait à dépasser une contradiction, l’impératif du premier étant une source d’invention formelle, celui du second étant un guide d’installation de la nature pour embellir la ville et lui offrir l’aboutissement d’un héritage de quais depuis son centre.
J’ai plus encore mesuré combien l’approche écologique était source d’invention formelle en concevant le parc Martin‑Luther‑King dans le quartier de Clichy‑Batignolles, à Paris, qui continue à croître à l’heure actuelle, en densité et en surface. Comme à Amiens, le parc est inscrit dans ce qui l’entoure, traversé par les lignes de la trame urbaine du quartier et connecté au‑delà puisque son axe principal se poursuit dans la banlieue limitrophe. Ces connexions offraient déjà la chance d’une singularité appuyée sur la singularité d’un contexte, mais c’est surtout
l’obligation d’une gestion la plus écologique possible qui m’a permis de rassembler un vocabulaire formel au service de cette gestion et de sa mise en scène à la fois : noues, éoliennes, plantes qui nettoient, eaux purifiées, bassins biotopes… des choses connues dans le dictionnaire des techniques jardinières, mais dont la réunion produit une phrase paysagère inédite. Conçu vingt ans après le parc de La Villette et quinze ans après le parc André‑Citroën, le parc de Clichy‑Batignolles entre à sa façon dans un champ d’écriture qui est peut‑être un « nouveau roman » du paysage urbain, un nouveau récit de la ville par les écritures paysagères. Lier, relier le proche et le lointain, tisser des liens, mitonner du liant… c’est sans conteste le paradigme le plus évident du métier de paysagiste. Il le partage avec ceux qui, comme lui mais au moyen de compétences différentes, sont aujourd’hui les urbanistes au travail. Il le partage aussi avec les métiers de la biologie, spécialistes de la vie végétale ou animale, dont les connaissances prouvent constamment que le domaine du vivant ne se découpe pas en parcelles séparées, que tout circule sans cesse et que la protection de la vie même passe par la protection des continuités territoriales. En toute logique, la nature et la ville ne doivent pas être isolées l’une de l’autre, la première doit se glisser dans la seconde, posséder ses chemins pour qu’y chemine la gent animale susceptible de nous accompagner et qu’y volent les graines au gré du vent et des becs d’oiseaux. C’est donc d’une progressive interpénétration dont le paysagiste doit avoir le souci dans ses projets et c’est ce dont j’ai pu me préoccuper à plusieurs occasions.
Ce fut le cas à Rennes en imaginant une ville‑bocage pour concevoir un nouveau quartier sur un ancien terrain agricole. En reprenant l’héritage de la trame des chemins qui circulaient entre les prés et les champs, j’esquissais une figure qui répondait en même temps à une volonté de continuité mémorielle et à celle d’une continuité biologique par connexion d’une trame urbaine à une trame rurale, par des passages abondamment plantés continuant les traverses bocagères. Mais ce parti pris n’était qu’un « essai », en 1998, avant que vingt ans plus tard je sois chargée de concevoir un projet pour la troisième phase, actuellement en cours, de l’aménagement de l’Île de Nantes.
Ce sera aussi le cas à Rouen dans le futur quartier Flaubert, où la proximité du fleuve a induit l’idée d’apporter l’eau et la végétation aquatique en plein coeur du site, au moyen d’une ligne de bassins successifs qui donne un axe au projet. Mais encore fallait‑il rendre possible une telle ouverture à la nature dans un territoire de friche industrielle traversé par de grandes infrastructures routières et ferroviaires. C’est sans doute là qu’un paysagiste apporte à l’urbanisme une logique singulière. Comme pour un simple jardinier dans son enclos, il était nécessaire de préparer le terrain avant de dessiner un projet : un moment d’urbanisme pur et dur au niveau des infrastructures, afin de les réorganiser en modifiant des trajectoires et des gabarits, en canalisant des flux de circulation, une sorte de défrichage de friche pour ménager un sol sur lequel pouvoir planter et bâtir, articuler les vides et les pleins dans une perspective d’équilibre de tous les éléments de ce qu’on peut appeler une densité hybride, mesure de l’occupation des sols qui ne se limiterait pas au nombre d’habitants au km² mais engloberait tout ce qui contribue à la qualité de l’espace public.
Mon travail actuel sur l’Île de Nantes est une occasion de rassembler toutes les expériences. L’aménagement de l’île, commencé au début des années deux mille, est un chantier infini à tous points de vue et déjà sa durée a permis de comprendre la valeur du temps long, voire de la lenteur, pour augmenter l’intelligence que l’on peut avoir d’un territoire urbain. Un temps qui remonte à des périodes très antérieures, depuis la fusion des îles de la Loire pour en faire un grand territoire à vocation majoritairement portuaire et industrielle, et qui se poursuit par des phases successives d’aménagement depuis la fin de ces activités — phases confiées à un paysagiste‑architecte, Alexandre Chemetoff, puis deux architectes, Marcel Smets et Anne Mie Depuydt, et maintenant à moi‑même avec l’urbaniste Claire Schorter. Tous les métiers de l’urbain ont participé à la transformation de l’île, avec une maîtrise d’ouvrage, élus et aménageurs, organisée de manière inédite, ce qui fait de ce territoire très particulier un véritable laboratoire de la fabrique de la ville dans les conditions du présent. Un présent si rapidement évolutif que chaque phase a été l’occasion d’aborder le territoire de façon différente. Chemetoff a créé des foyers d’intensité paysagère dans ce qu’on a souvent appelé une stratégie d’acupuncture urbaine. Smets et Depuydt ont découpé l’île en grandes unités qui sont autant de programmes diversifiés de transformations. Je suis, depuis 2017, dans la situation du troisième passage de relai d’un parcours dont la fin n’est pas fixée. D’autres viendront aménager l’Île de Nantes après moi.
On ne peut guère trouver plus disparate que ce que l’on voit sur l’île, et ce qui frappe aujourd’hui, c’est la posture très constante chez les paysagistes, ici de façon manifeste, devant cet état des choses hérité du passé par accumulations et logiques variées : faire avec, faire alliance avec l’existant, s’y glisser en s’y appuyant, jusqu’à progressivement en révéler des valeurs d’usage et des beautés paysagères. Je redis ce que j’écrivais il y a deux ans, il s’agit pour moi de créer des convergences dans le disparate, de saisir le dépôt des siècles dans une même trame, de nature et d’urbain, c’est‑à‑dire un socle liant toutes les strates — géologie, géographie, histoire et mémoire —, un socle et un sol fertiles à tous points de vue, pour un urbanisme qui soit cette alliance générale qui est pour moi un objectif essentiel du paysagiste‑urbaniste. L’après‑pandémie va sans doute offrir une assise plus forte à ce parti pris du réel qui me conduit, sur le territoire de l’île, à concevoir un quartier, un système de parcs, un tissage de continuités pour la vie biologique et sociale : un paysage urbain.
Fabriquer la ville est, à mes yeux, une mécanique de précision — ce qui est une des bases de l’enseignement que je donne à l’école de la Nature et du Paysage de Blois. Tout doit s’ajuster, le socle de la ville est une épaisseur où se joue, du sous‑sol à la surface, une négociation permanente, entre les racines et les réseaux, entre la terre et le béton, entre les vides et les pleins, entre les murs et les arbres… Cela implique une action continue contre l’inertie des logiques de l’aménagement, séparées au point de s’ignorer les unes les autres, forçant à se battre pour qu’une surface « verte » sur un plan-masse se traduise véritablement parun espace « vert », planté en pleine terre, nourri par les eaux. Forçant à se battre aussi contre les figures attendues d’une ville ou de ses fragments, et se sentir toujours capable d’imaginer des lieux, comme le futur quartier « finistère », à la pointe de l’Île de Nantes, où l’on se prendrait à rêver d’une ville bâtie là comme la proue d’un navire, qui allierait la beauté des docks à l’intimité d’une ville en coulisse, pleine de surprises urbaines, où l’on entendrait le bruit des pas, le cliquetis des vélos mêlés aux sirènes des bateaux… rêver d’un entrelacs de chemins d’une nature foisonnante pour une Venise verte au milieu d’un parc… ou d’une médina dans l’herbe…
Le projet repose sur une étroite intrication des vides et des pleins, au moyen de dispositifs qui rendent les surfaces bâties plus poreuses et ainsi plus hospitalières, en multipliant le plus possible les interfaces, les seuils doit‑on dire pour ne pas oublier que c’est à ce niveau, depuis les Grecs, que se pratique, se ressent et se pense l’hospitalité. Architectures poreuses et hospitalières à tous points de vue, car le plan‑masse découpe le site en multiples parcelles de tailles diverses et les programmes attribuent ces parcelles à de multiples acteurs où se jouent des répartitions inédites entre promotions publiques et privées, entre maîtrises d’oeuvre très encadrées et conceptions partagées avec la vie associative — un morceau de ville qui cherche à établir la complexité dans un monde complexe, là où la disparition des activités anciennes a laissé un sol libre qu’on aurait pu considérer au siècle dernier comme une table rase et qu’on sait aujourd’hui porteur en réalité de multiples traces géographiques, techniques et sociales où puiser l’amorce d’une richesse composite aussi grande que celle de la ville ancienne, mais autrement.
Comment faire de la ville complexe, dans le cas où l’on doit partir de rien ou presque rien, alors que l’histoire nous laisse la preuve du bénéfice de la complexité, de sa convenance au plaisir de vivre en ville ? Sans doute avec des dispositifs autant qu’avec du dessin, comme je l’expérimente à Nantes avec Claire Schorter, mais également avec de l’indéfinition et de l’inachèvement. Une double indéfinition ici, car le projet nantais repose sur une ossature ramifiée qui permet d’échapper aux catégories traditionnelles de l’urbanisme en jouant d’un maximum d’intrication de ce qui est habituellement séparé, parcs et bâtiments, chemins et chaussées, jardins et trottoirs… Et indéfinition due à l’inachèvement du programme et de sa réalisation, ce qui est à la fois voulu et imposé. L’Île de Nantes verra intervenir de nouveaux acteurs pendant longtemps encore, qui varieront les orientations préalables établies par les trois premières équipes choisies pour son aménagement. Ce qui fera l’objet de nouvelles phases est encore en suspens, des lieux sans affectation attendent d’être investis. Le présent lui‑même est un inachèvement. Mon équipe et moi préparons l’accueil de réalisations futures autant que nous allons en faire nous‑mêmes pendant le temps imparti à notre mission. Mais je peux affirmer que cette situation est bénéfique, car elle impose de concevoir
notre action comme une impulsion, un point de départ vers la fabrication non figée d’un morceau de ville, et peut‑être une stratégie le plus souvent souhaitable à l’heure actuelle, une stratégie de lancement d’un nouvel
urbanisme, sans cesse ouvert à tous les possibles, capable de répondre aux bouleversements climatiques ou sociaux, économiques ou culturels… notre avenir.
Jacqueline Osty